
10 conseils pour être un bon coach rapidement !
10 conseils pour être un bon coach rapidement !
Je considère le métier d’entraîneur comme une passion. À mon avis, il est difficile de s’investir dans ce métier où vous devez transmettre vos connaissances de notre sport sans cette passion.
Lorsque vous entraînez, vous êtes le garant de l’intégrité physique de vos joueurs à travers votre planification.
C’est pourquoi vous devez avoir de solides connaissances sur le fonctionnement du corps humain, car pratiquer un sport, c’est bien, mais rester en bonne santé physique, c’est encore mieux !
Bien au-delà de cette intégrité physique, qui est le fil rouge de mon rôle d’entraîneur, vous devez être le moteur de vos séances !
Honnêtement, c’est cet aspect qui est le plus difficile à maintenir dans la durée. Nous avons tous des hauts et des bas au cours de notre carrière, et il est important d’en avoir conscience afin de les anticiper et de ne pas devenir un « entraîneur sans passion ».
Cela fait maintenant un peu plus de 10 ans que j’entraîne quotidiennement, et je pense avoir eu la chance d’entraîner tous types de publics, du joueur de haut niveau en équipe de France aux adultes débutants, en passant par les jeunes dès l’âge de 3 ans.
Toutes ces expériences ont forgé ma vision du badminton et mon adaptabilité en fonction des attentes de ces publics. C’est aussi grâce à ces expériences diverses que mes certitudes dans l’entraînement se sont finalement estompées…
Plus vous entraînez, plus vous comprenez qu’avoir des certitudes et des idées arrêtées ne fera pas de vous un bon entraîneur. Vous devez comprendre que pour cela, vous devez remettre en question en permanence vos connaissances et vous former continuellement.
Depuis quelques années, je passe beaucoup de temps à écouter des podcasts et à regarder des vidéos sur des visions que je ne partage pas du tout, afin d’essayer de comprendre si ce n’est pas moi qui suis sur la mauvaise voie… et j’ai l’intime conviction que peu importe les visions et les méthodes, il y a toujours quelque chose à en tirer !
« Rien n’est plus dangereux que la certitude d’avoir raison. » – François Jacob
« L’extrême netteté, la clarté et la certitude ne s’acquièrent qu’au prix d’un immense sacrifice : la perte de la vue d’ensemble. » – Albert Einstein
Tout cela pour te dire que c’est l’un des plus beaux métiers que de transmettre, mais qu’il n’est pas de tout repos. Ainsi, si je peux t’aider avec mon expérience, c’est avec plaisir que je vais te donner quelques conseils que j’aurais aimé avoir à mes débuts…
-
Prendre chaque joueur comme un individu distinct :
C’est certainement l’une des choses les plus importantes en matière d’entraînement. Nous avons tendance à entraîner chaque joueur de la même manière, en donnant des consignes identiques à chacun. Cependant, chaque personne arrive à l’entraînement avec un vécu et des expériences de vie différentes, ce qui signifie qu’elle a un système nerveux plus ou moins adapté au badminton. Tu dois donc prendre cela en considération et t’adapter à chacun de tes joueurs. Le corps est une formidable machine d’apprentissage, mais il a besoin de temps, alors ne sois pas trop pressé.
-
Ce qui est simple pour une personne ne l’est pas forcément pour une autre :
Tout comme le point précédent, un joueur peut réussir très facilement à mettre en application tes conseils, tandis qu’un autre peut avoir des difficultés. La responsabilité peut incomber aux deux parties, alors peut-être devras-tu revoir certaines consignes et fournir un feedback tactile ou visuel pour plus de pertinence. Une personne qui n’a pas encore acquis suffisamment de schémas moteurs liés au badminton les acquerra avec le temps, à condition qu’elle soit patiente. Je te conseille d’insister sur ce point : LA PATIENCE.
-
La charge d’entraînement est une chose, mais la charge « humaine » est plus impactante :
Si tu es entraîneur, alors tu dois certainement élaborer une planification d’entraînement, ce qui signifie que tu dois savoir comment ajuster les paramètres de tes exercices pour amener ton joueur à être en forme pour sa compétition et éviter la surcharge ou la sous-charge. Le problème, c’est que nous nous concentrons principalement sur la charge théorique d’entraînement, mais il est également essentiel de prendre en considération la charge humaine de sa journée. Tu auras donc la charge purement objective, telle que le nombre de volants, les séries, le temps de travail et le temps de repos. En plus de cela, il y a la charge subjective, comprenant le RPE (l’effort perçu), l’état mental avant la séance, la forme physique à l’instant T et l’état social du joueur (famille, relations amoureuses, etc.). Les paramètres subjectifs sont beaucoup plus importants à prendre en compte dans ta planification si tu veux préserver l’intégrité physique de tes joueurs.
-
Le principe de répétition sans répétition :
Si tu as une certaine formation sur le corps humain et ses fonctions, tu dois savoir qu’il n’existe jamais deux mouvements identiques. Lorsque tu effectues un travail de répétition, tu ne pourras jamais reproduire le même schéma moteur, mais tu vas entraîner ton système nerveux à emprunter des chemins différents pour atteindre un même résultat. Il est même primordial de travailler dans ce sens en développant tes capacités physiques, notamment en ce qui concerne la mobilité
articulaire. -
Comment fonctionnent nos tissus, et plus particulièrement nos articulations :
Ce point est lié au précédent, car plus ta mobilité est restreinte, plus tu vas utiliser la même trajectoire, « utiliser les mêmes tissus ». Si c’est le cas, ils vont se dégrader plus rapidement. Imagine cela comme une pelouse où tu marches tous les jours au même endroit. Si tu le fais, l’herbe ne pourra jamais pousser. Comprendre comment une articulation fonctionne te permettra de proposer des exercices qui respecteront ce pour quoi elles sont conçues ! Mais n’oublie pas une chose : le corps humain s’adapte, et naturellement, s’il y a un dysfonctionnement articulaire, ton corps créera une compensation pour accomplir la tâche. C’est à ce moment-là qu’il faudra être prudent pour éliminer cette compensation petit à petit.
- Apprendre la régularité et la consistance plutôt que d’apprendre à terminer l’échange :Naturellement, les joueurs veulent conclure l’échange car ils veulent gagner. Ils te demanderont constamment comment frapper plus fort, faire des smashs plus précis, etc. Cependant, dans le badminton, l’une des méthodes pour gagner est de maintenir le volant dans le terrain. Pour moi, c’est le premier point à développer chez tous les joueurs que tu entraîneras : la consistance et la régularité passent avant tout ! Si tu changes de perspective, tu verras rapidement le niveau de tes joueurs s’améliorer considérablement !
Se concentrer sur le fait de renvoyer le volant une fois de plus que l’adversaire avec une bonne trajectoire te permettra de remporter la majorité des échanges et de structurer ton jeu ! - Prendre du recul par rapport aux décisions de l’entourage des joueurs : Ce métier est une passion, et tu connaîtras des déceptions. Tu t’investiras sans compter, mais tes joueurs te quitteront parfois et prendront un chemin différent. J’ai vécu cela et je n’y étais pas préparé. Cela m’a beaucoup affecté, mais la réalité est que tu ne dois rien attendre en retour de ton investissement. Que ton joueur prenne la bonne décision ou non, avec ou sans toi, il est maître de son destin, et il pense faire le meilleur choix pour lui, ce qui est respectable. Donc, ne prends jamais cela comme une affaire personnelle, cela t’épargnera bien souvent des tracas.
- Il n’y a aucune certitude dans l’entraînement d’un être humain :Nous ne sommes pas des voyants, nous n’avons aucun droit de dire qu’un joueur a plus de potentiel et réussira mieux qu’un autre. Tu dois comprendre que ta vision du badminton et de l’entraînement n’est pas infaillible. L’entraînement d’un être humain est très complexe, et tu ne peux pas prétendre qu’il ira plus loin qu’un autre joueur simplement parce qu’il est bon physiquement, techniquement, ou que tu penses qu’il est talentueux. La route est longue, très longue, et crois-moi, si tous les joueurs que nos instances ont détectés comme ayant un fort potentiel étaient au sommet de leur jeu, nous aurions déjà remporté de nombreux titres mondiaux depuis longtemps !
-
Le plus important chez un jeune n’est pas son potentiel, mais son « esprit de développement ».
Cela devrait être le seul critère que nous devrions considérer. Aujourd’hui, ce qui m’intéresse le plus chez un joueur lorsque je l’entraîne, c’est son état d’esprit. Il y a deux types de personnes quand on est confronté à l’adversité : la personne qui veut toujours se confronter à des défis plus grands pour progresser et celle qui a tendance à jouer contre des adversaires de niveau similaire pour valider ses acquis. Et, c’est ce point qui est, pour moi, le plus important !
La technique ou la condition physique sont figées à un instant donné. En revanche, l’état d’esprit d’une personne est influencé par sa famille ou son entourage, et cela ne change que très peu à long terme. (Mais attention, car on peut évoluer son état d’esprit dans un sens comme dans l’autre… à toi de veiller à ce qu’il se développe correctement). -
Toujours continuer à se former et à apprendre ! :
Je suis sorti de ma carrière de haut niveau avec de fortes convictions sur la manière d’entraîner. Aujourd’hui, on peut dire que ces convictions ont considérablement évolué ! Une chose qui est très difficile une fois que tu as obtenu un diplôme, c’est de te remettre en question et de faire évoluer ta façon de penser. Actuellement, en France et ailleurs, il y a des entraîneurs qui vivent de leur métier et qui enseignent un badminton des années 80-90. Ils utilisent des méthodes obsolètes et, sans s’en rendre compte, mettent en danger l’intégrité physique des joueurs. Loin de moi l’intention de critiquer ces personnes, car chacun est libre de son engagement professionnel, et tant qu’il est en accord avec sa conscience, c’est très bien pour lui. Cependant, personnellement, je considère que si tu n’es pas engagé dans une démarche de formation continue pour t’améliorer en tant qu’entraîneur, alors tu perds déjà pied. L’été dernier, avec Maxime, nous avons lancé notre première formation continue, et il y en aura beaucoup d’autres lors cette année, sous forme de week-ends et de semaines. Si cela t’intéresse, n’hésite pas à me répondre à ce mail.
Bon entrainement !
Laurent
Train harder but smarter
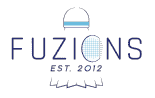

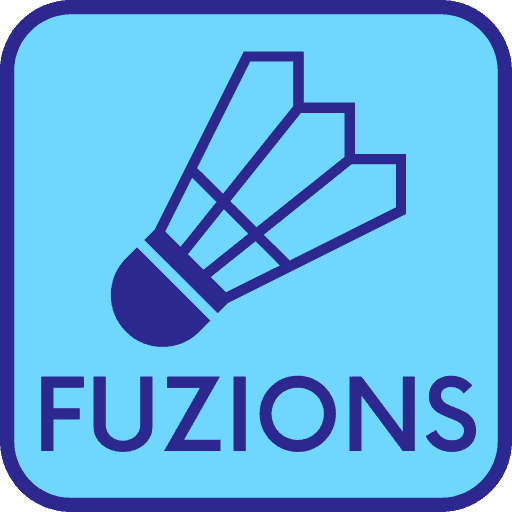


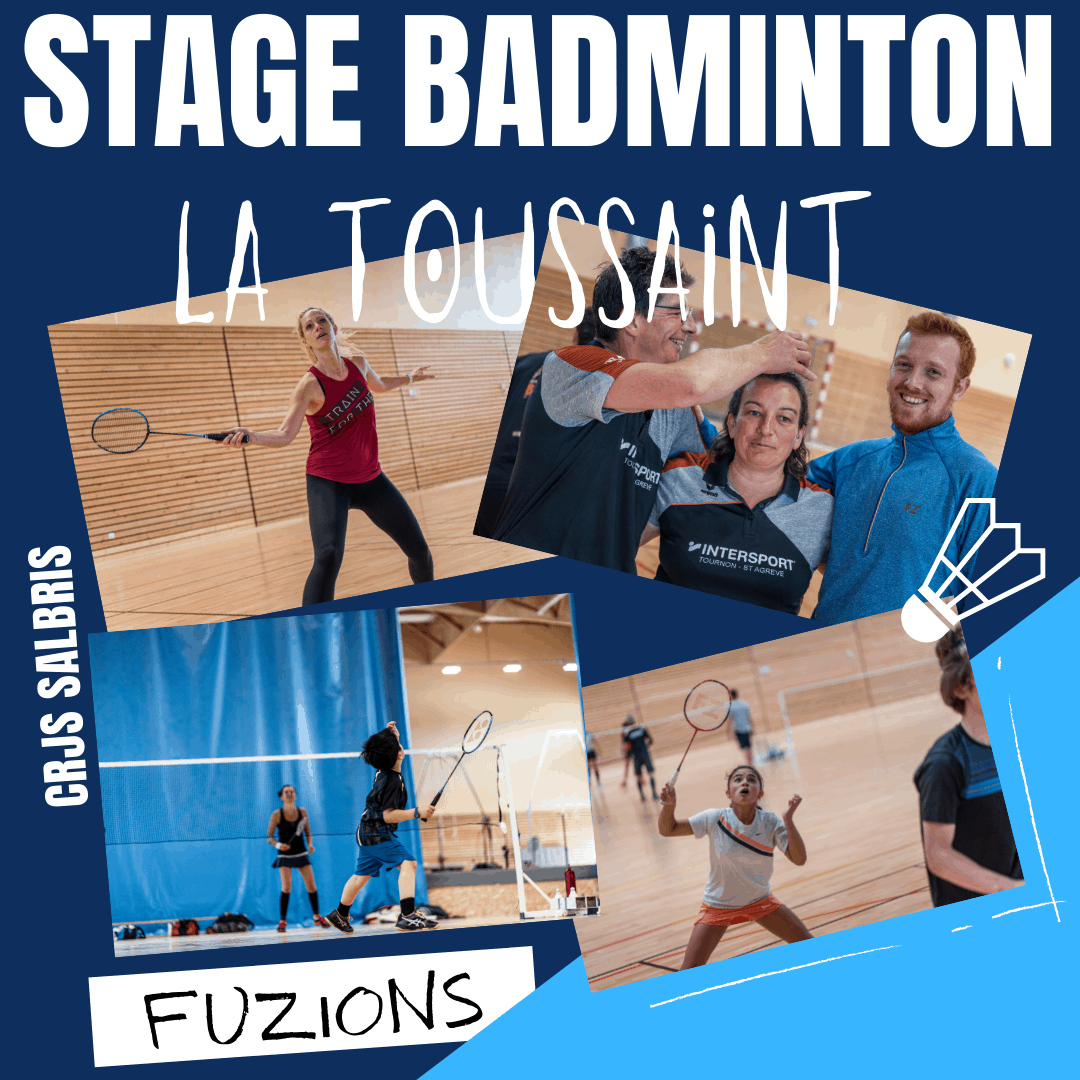
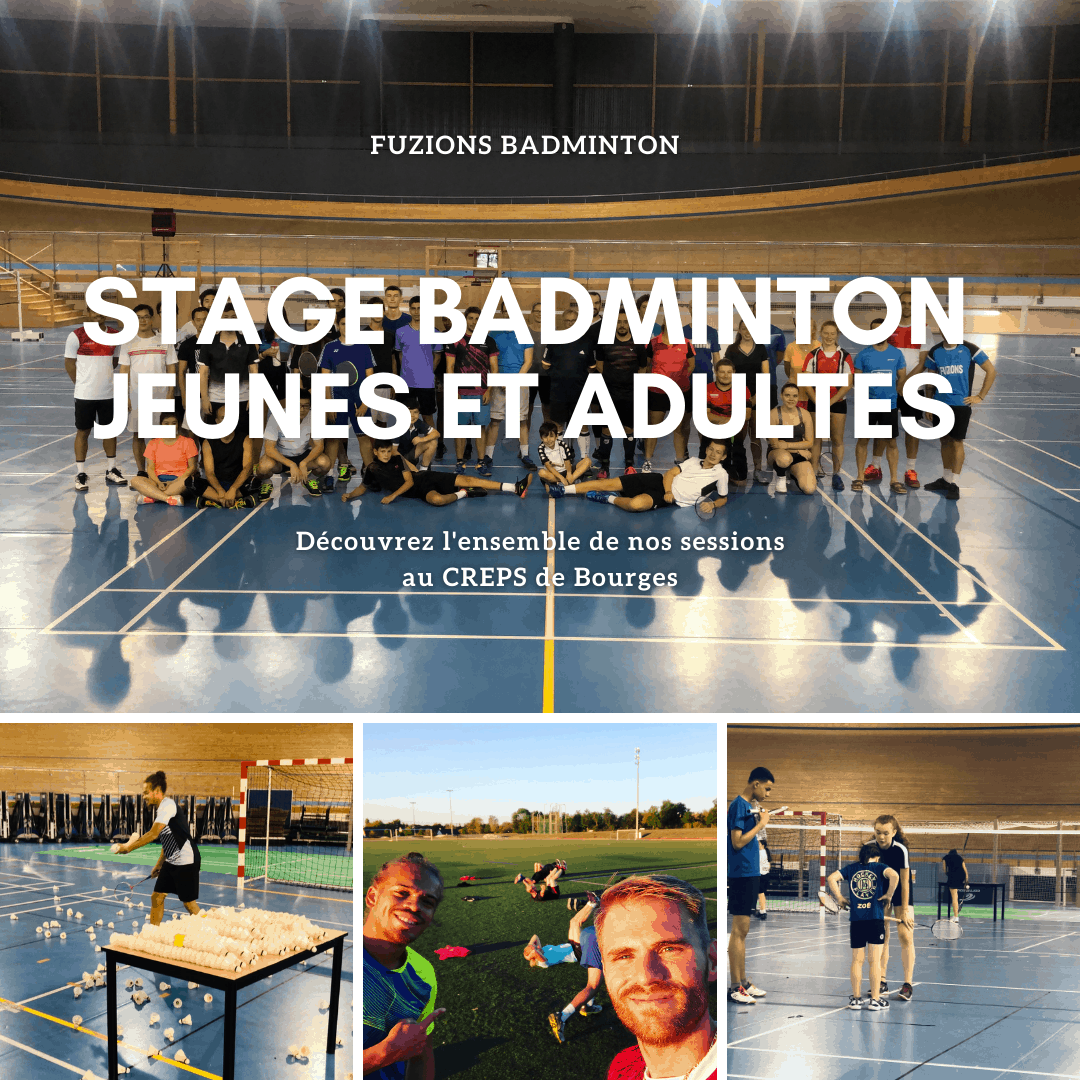

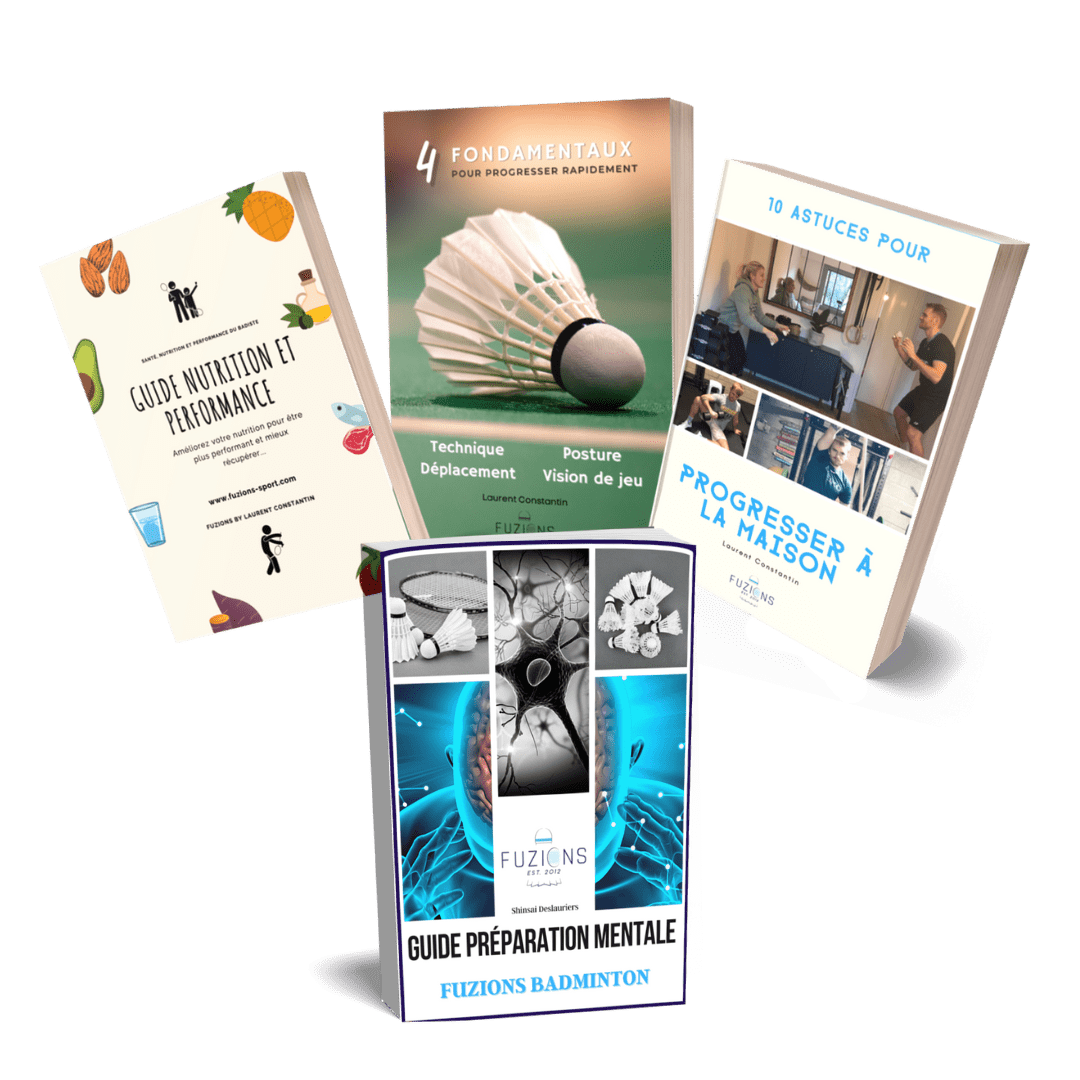
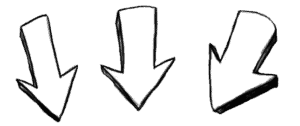


Commentaires récents